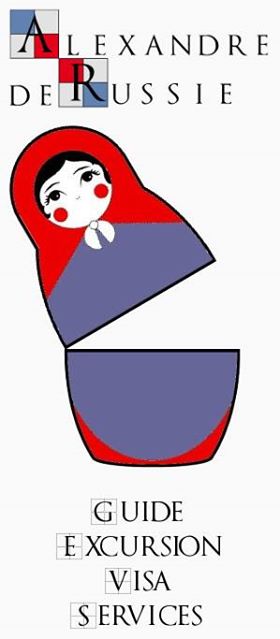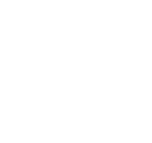Teodor Currentzis : « il y a trop de musique dans ce monde »
Pour un grand chef d'orchestre, s'installer à Perm (Oural) serait-il une faute de parcours ou au contraire le sacrifice d'un puriste en quête de liberté ? Après une soirée passée à l’Opéra de la ville, il faut se rendre à l'évidence : Teodor Currentzis ne s’est pas égaré à Perm ; il y a construit un monde à part, une utopie dédiée à la musique.

© Olya Runyova
Le théâtre de Perm est un beau bâtiment du XIXème, niché dans le jardin central de la ville. Reconstruit en partie après plusieurs incendies, la scène, en revanche, est celle des origines. C’est ici, il y a plus d’un siècle, que Serge Diaghilev a découvert le spectacle vivant. Depuis 2011, c'est Teodor Currentzis, chef d’orchestre né en Grèce, formé au Conservatoire de Saint-Pétersbourg et à la tête de l’Opéra de Novossibirsk de 2004 à 2010, qui lui redonne sa puissance d’avant-garde et lui insuffle son exigence.
Le public, lui, est réceptif, attentif, et son attitude éloignée des fréquentes vulgarités moscovites. Le plaisir de jouer, visible sur les visages des musiciens de l'ensemble Musica Aeterna fondé par le chef, vous frappe. Quant aux danseurs , ils participent de cette sensation de vitalité et d’immense maîtrise. L'atmosphère toute entière du lieu est propice à la création et le spectacle une œuvre d’art totale. L’orchestre, les voix, les corps, les décors, chaque détail, en passant par les costumes, concourt à former un tout parfaitement harmonieux, puissant, drôle.
Quant au talent du chef et à ses choix en matière de direction, bien des critiques les ont abondamment commentés. Ses tournées en Europe sont triomphales, comme à Aix-en-Provence cet été. Perm rayonne ainsi mondialement. Enfin la troupe de danse est généralement considérée comme
à Aix-en-Provence cet été. Perm rayonne ainsi mondialement. Enfin la troupe de danse est généralement considérée comme la troisième la plus importante du pays : tout ceci est établi.
la troisième la plus importante du pays : tout ceci est établi.
Reste qu'une impression singulière se dégage de ce théâtre ; le sentiment que quelque chose d’unique se passe à Perm, et ne pourrait certainement pas se passer ailleurs. Un peu comme si un territoire utopique avait été créé par le maître et ceux qui l’entourent et où seule la musique compterait.
si un territoire utopique avait été créé par le maître et ceux qui l’entourent et où seule la musique compterait.
Au sortir de scène, après avoir dirigé Orango et Tué sous condition de Dmitri Chostakovitch, Teodor Currentzis nous a accordé une interview.

Teodor Currentzis © Anton Zavjyalov
La Dame de Pique : Parlez-nous de la relation que vous entretenez avec Chostakovitch.
Teodor Currentzis : « Chostakovitch est un compositeur dont on réduit souvent la portée. Je ne pense pas qu’il soit correct de juger un artiste de son envergure au regard des difficultés de sa vie sous l’Union Soviétique. Bien sûr la musique peut être engagée, voire résulter d’une situation politique. Mais Chostakovitch aurait été un immense compositeur dans n’importe quel pays et à n’importe quelle époque.
En fait, je me sens en désaccord aussi bien avec les interprétations soviétiques qu’avec les interprétations occidentales de sa musique. On se trompe sur Chostakovitch. On oublie qu’il connaissait le travail de Krysztof Penderecky, ou de Giorgy Ligeti. On ne fait jamais ces connections. Il est crucial de voir Chostakovitch comme un compositeur vivant, avec un grand sens de l’humour, un regard caustique et satirique sur les choses, et de ne pas lui construire un mausolée, y planter le drapeau rouge et en rester là.
un compositeur vivant, avec un grand sens de l’humour, un regard caustique et satirique sur les choses, et de ne pas lui construire un mausolée, y planter le drapeau rouge et en rester là.
Ce que nous avons fait ce soir, nous l’avons fait en partie dans les décors avant-gardistes d’origine de Alexandra Exter que nous avons récupérés dans un musée. C’est une sorte de reconstitution de l’esprit que pouvait avoir Chostakovitch dans les années 1930. A ceci près que toutes les choses qui se passent ici, qui ont cet « air » d’Union Soviétique, n’auraient jamais pu réellement ressembler à ça, à cette époque, comme vous pouvez le comprendre !
vous pouvez le comprendre !
LDDP : Chostakovitch aurait finalement été très heureux d’avoir la possibilité de faire ce que vous avez fait ce soir...
TC : Bien sûr ! Cette performance, précisément, est ce que Chostakovitch aurait aimé pouvoir voir à l’époque !
LDDP : Vous dites régulièrement que vous travaillez uniquement sur partitions. Mais visiblement, l’étude de la vie des compositeurs tient également une grande place dans votre réflexion ?
TC : Oui, je travaille beaucoup en bibliothèque, mais ça ne suffit pas. Si nous continuons à parler de Chostakovitch, quand j’ai dirigé Lady Mac Beth à Zurich, sa veuve, Irina Antonova Chostakovitch, a assisté à la représentation, m’a remercié et m’a dit : « vous devez travailler sur deux œuvres fantastiques : Orango et Tué sous condition qui n’ont pas encore été montées ensemble, comme elles devraient l’être. » J’ai alors voulu aborder un autre aspect de ce personnage.
elles devraient l’être. » J’ai alors voulu aborder un autre aspect de ce personnage.
Ainsi, j’entre dans une relation véritablement vivante avec lui, une relation très réelle. Mais paradoxalement, une relation qui n’aurait jamais pu exister de son vivant. Car il n’aurait jamais pu dire ce qu’il voulait vraiment voir, les limites étaient trop fortes.
LDDP : Vous avez dit que les grandes villes, les gens, sont une pollution pour un artiste. Vous pensez qu’un compositeur doit être solitaire, coupé de son époque ?
TC : Non, non, je pense que l’art peut être politique. Parce qu’évidemment nous vivons dans un monde où il est nécessaire de se parler. Et bien sûr, il y a quelque chose de politique dans le fait de mener cette représentation, encore aujourd’hui, parce que nous ne sommes pas non plus contents de ce qui se passe en ce moment en Russie. Et c’est drôle, parce que les conservateurs, qui eux souhaitent revenir à ce qu’était la Russie il y a 30 ans, étaient très contents du spectacle et ils y voient encore un vrai chef d’œuvre communiste : ils ne perçoivent pas du tout son ironie !
LDDP : Vous pensez avoir un véritable devoir envers ceux dont vous interprétez les œuvres ?
C’est ma mission en tant que musicien, de réaliser les espoirs de ces compositeurs. Ici rendre l’esprit originel de Chostakovitch, avant que, d’ici un siècle, on ne soit plus capable de reconnaître sa musique, comme cela nous est arrivé pour Beethoven ou Mozart. Si vous écoutez les enregistrements des années 1960 ou 1970, par les plus grands orchestres, c’est un cauchemar.
cela nous est arrivé pour Beethoven ou Mozart. Si vous écoutez les enregistrements des années 1960 ou 1970, par les plus grands orchestres, c’est un cauchemar.
Mais cela ne signifie pas qu'il faut chercher à imiter la manière dont on jouait de la musique au XVIIIe. Cela signifie qu'il faut rendre possible des rêves qui ne se sont pas réalisés.
Prenons un exemple : vous avez composé un morceau. On prend la partition pour en donner la création. Et puis il faut aller vite, il y a des erreurs, on joue certaines choses d’une manière qui ne vous convient pas, mais vous ne dites rien, le temps passe. Cent ans plus tard, vous allez au bal, vous entendez cette musique qui depuis a toujours été jouée de la même manière, vous dites merci à tout le monde, vous souriez, et puis vous rentrez chez vous pleurer dans les bras de votre femme. Or c’est ce qui se passe 90% du temps !
Et puis un siècle plus tard, vous trouvez un enregistrement, et ça y est, vous entendez que j’ai réalisé l’interprétation que vous souhaitiez. Et enfin c’est authentique, qu’importe le temps que ça a pris, ça y est.
On sait par exemple que Beethoven a écrit dans les partitions de ses Symphonies certaines indications très précises et lorsqu’on les a redécouvertes, on s’est demandé ce que ça pouvait bien être ! Parce que pendant des décennies, au moment de jouer cette musique, parmi les musiciens de l’orchestre, certains étaient amateurs et incapables d’interpréter les passages les plus difficiles. Alors pour ne pas le jouer trop mal, on a décidé de reprendre certains passages comme
pour ne pas le jouer trop mal, on a décidé de reprendre certains passages comme ceci ou comme
ceci ou comme cela. Mais vous comprenez bien que cela ne signifie pas qu’il faut continuer à le jouer de cette manière aujourd’hui.
cela. Mais vous comprenez bien que cela ne signifie pas qu’il faut continuer à le jouer de cette manière aujourd’hui.
Vous savez, je travaille avec beaucoup de compositeurs vivants, de grands compositeurs. Et tout passe par le dialogue. « Tu as écrit ça comme ça, moi je l’aurais plutôt joué comme ça, essaie. – Ok, on voit ce que ça donne. » Et c’est ainsi que des partitions évoluent. Chostakovitch par exemple, dans la 5ème Symphonie, a écrit au départ le scherzo pianissimo leggero. Après première écoute, il a décidé de l’essayer fortissimo secco. Et là, ça lui a plu ! Il a changé la partition. Mozart a fini l’ouverture de Don Giovanni quelques heures avant le lever de rideau de la première représentation.
ça, moi je l’aurais plutôt joué comme ça, essaie. – Ok, on voit ce que ça donne. » Et c’est ainsi que des partitions évoluent. Chostakovitch par exemple, dans la 5ème Symphonie, a écrit au départ le scherzo pianissimo leggero. Après première écoute, il a décidé de l’essayer fortissimo secco. Et là, ça lui a plu ! Il a changé la partition. Mozart a fini l’ouverture de Don Giovanni quelques heures avant le lever de rideau de la première représentation.
Il est primordial de comprendre que vous devez être en contact permanent avec le compositeur, même par l’imagination. Personne n’a raison. C’est l’intuition et le talent qui jouent le plus grand rôle.
LDDP : Mais alors quel est le problème selon vous des interprétations d’autres chefs d’orchestre ?
quel est le problème selon vous des interprétations d’autres chefs d’orchestre ?
TC : Ils lisent juste la partition, sans entrer véritablement dans les détails. Pas tous bien sûr ! Mais la plupart. Et ils reproduisent, simplement. Sans recherche. Les notes sont juste un code. L’important n’est pas de jouer le code, mais de lire le texte. Et ensuite de lui donner son esprit. Lire simplement, ce n’est pas de l’art.

Teodor Currentzis © Olya Runyova
LDDP : A chacune de vos interprétations vous avez quelque chose de particulier à dire ?
TC : Quand j’ouvre une partition, je sais ce qu’il y a à l’intérieur. Si je ne le sais pas, je ne la joue pas. Si je ne sens pas la magie qu’il y a dans une œuvre, si je ne veux pas exprimer cette magie, je ne prends pas la décision de la jouer.
Je vais vous dire une chose. Mon opinion est qu’il y a bien plus de musique dans ce monde que nous n’en avons besoin. Et c’est un problème. Vous allumez la télévision, la radio, vous entendez de la musique, et ça continue dans la rue, au restaurant, dans les magasins. On se rend au concert chaque semaine, et personne ne se concentre véritablement sur la musique, on la vide de sa substance. C’est comme si nous faisions tous des enfants, chaque jour. Alors
si nous faisions tous des enfants, chaque jour. Alors ces enfants peuvent bien mourir, personne ne se sentira triste pour eux.
ces enfants peuvent bien mourir, personne ne se sentira triste pour eux.
Mais si vous avez eu une préparation, que quelque chose vous a manqué, que vous avez lutté pour cela, alors la musique vous parle. Une représentation ne peut pas être la routine de l’usine. Il faut qu’il y ait une attente, que l’on s’ouvre à une certaine émotion.
la musique vous parle. Une représentation ne peut pas être la routine de l’usine. Il faut qu’il y ait une attente, que l’on s’ouvre à une certaine émotion.
Mais les interprètes travaillent bel et bien à l’usine. Et les gens, dans le public, viennent écouter tout cela sans se demander intérieurement pourquoi. Pourquoi est-ce qu’ils sont là, qu’est-ce qu’ils attendent ?
LDDP : Et vous pensez que c’est plus difficile aujourd’hui, qu’au temps de Chostakovitch par exemple ?
TC : Oui je pense que c’est plus dur.
C’est notre époque, on n’ose pas se dire les choses face à face, en se regardant dans les yeux, sans Internet, se dire certains mots, prendre ce risque immense... Plus personne ne prend le temps de s’asseoir seul dans une pièce, pour écouter de la musique, et écouter ses sentiments, comprendre ce qu’il a en lui. Pour ressentir cette sorte de radicalité, quand la musique dit fort ce qui est enfoui au plus profond de vous.
LDDP : Mais n’y a-t-il pas toujours quelque chose de particulier en Russie, dans cette réception de la musique ?
TC : La Russie est immense, c’est une bonne chose. Et elle possède tout. Elle a un pouvoir qui est hors de la compréhension de quelqu’un qui ne vivrait pas ici.
Vous pouvez y rencontrer des gens incroyables, ouverts, talentueux, qui s’acharnent à créer une nouvelle vague musicale, comme cela a pu exister par le passé. Dans cet immense espace chaotique, dans toutes ces nationalités, il y a cette chimie qui amène des résultats formidables. Vous savez, le ballet est français, ou plutôt franco-italien. Et les Russes l’ont pris, mais l’ont exprimé avec leur propre accent. Or, certes, le ballet académique russe n’est pas exactement correct, si l’on suit strictement la tradition académique, mais c’est bien le plus grand ballet du monde. Car il exprime vraiment quelque chose, d’exotique et de profond, que l’on ne trouve plus dans le ballet français, devenu trop propre et trop froid. Il faut être radical. »
cela a pu exister par le passé. Dans cet immense espace chaotique, dans toutes ces nationalités, il y a cette chimie qui amène des résultats formidables. Vous savez, le ballet est français, ou plutôt franco-italien. Et les Russes l’ont pris, mais l’ont exprimé avec leur propre accent. Or, certes, le ballet académique russe n’est pas exactement correct, si l’on suit strictement la tradition académique, mais c’est bien le plus grand ballet du monde. Car il exprime vraiment quelque chose, d’exotique et de profond, que l’on ne trouve plus dans le ballet français, devenu trop propre et trop froid. Il faut être radical. »