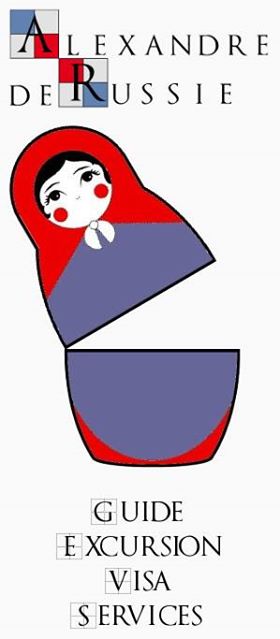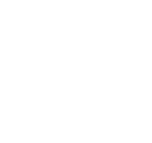Gleb, ex-réfugié tchétchène : « Je suis plus français que les Français eux-mêmes »
De Grozny au Havre, de Russie en France, Gleb a tout connu : les guerres, l'exode, la vie dans la rue, la faim, la débrouille. Russe de Tchétchénie, il vit aujourd'hui à Paris. Gleb nous a raconté son histoire.
Le jeune Gleb a six ans quand éclate la première guerre de Tchétchénie en 1994. « J'ai de vagues souvenirs de la guerre, raconte-t-il, mais j'ai un souvenir très net du premier bombardement. J'étais chez mes grand-parents, non loin de l'aérodrome de Grozny, qui fut l’une des premières zones à être bombardée. Je me souviens des fenêtres qui volaient en éclats. »

Gleb Khassouev © Lukas Aubin
A l'époque, on ne sait pas qu’à cette guerre en succèdera une autre. Gleb et sa famille croient alors pouvoir rester à Grozny, la capitale. Mais après 1999, la famille n’a plus guère le choix : tandis que Grozny vient d'être rasée, les aides promises par l’Etat russe n'arrivent pas. Il ne fait d’ailleurs pas bon être russe de Tchétchénie à Grozny. Sans compter que la crise économique fait rage ; la guerre coûte cher. Les déplacés des deux conflits tchétchènes – les « dommages collatéraux » – sont les grands oubliés.
« Nous avons fui à Veliky Novgorod (ville du nord-ouest de la Russie, NDLR), dans l'espoir d'une vie meilleure, reprend Gleb. Mais la vérité, c'est que les caisses de l'Etat étaient vides et que nous étions sans le sou ». Très vite, plus rien ne les retient ici. Il faut « passer de l'autre coté », comme cela se dit à l'époque. « Mon père avait dans l'idée d'aller en France depuis des années, poursuit Gleb. Pour mon père comme pour beaucoup de Russes, la France était le pays de la liberté et de la Révolution. » D’un geste assuré, le jeune homme allume une cigarette. Sa voix, elle, tremble un peu.
Veliky-Paris
« En janvier 2001, la décision fut prise : nous avons grimpé dans un conteneur, destination la France. C'était parti pour trois jours et demi de voyage. J'avais douze ans, je quittais la Russie sans savoir que je ne reviendrai pas. » La famille de Gleb laisse derrière elle un pays exsangue. Au total, les deux guerres de Tchétchénie ont fait près de 175 000 victimes et Grozny a été rayée de la carte avant d'être reconstruite.
L’espace d’un instant, les grands yeux clairs plongent dans le vague. Gleb a la barbe fouillie et déjà quelques mèches de cheveux blanches. « Ça, c’est parce que j'ai des soucis », rigole-t-il. « J'ai vieilli un peu trop vite, et puis j'ai fait beaucoup de conneries aussi ». Il cherche ses mots - l’accent russe est très fort mais le français impeccable. « J'écoute France Culture tous les jours, ça m'apprend à penser et à parler ».
Quand il se raconte, Gleb donne le sentiment de lire une histoire. Il a le sens de la formule et le phrasé parfois pompeux. Le discours est bien rôdé. Un discours qui laisse à penser qu’ils furent nombreux à tenter de le faire trébucher.
« On a passé la plupart du trajet enfermés sans voir la lumière du jour. Mais je me souviens qu'on a traversé la Tchécoslovaquie qui n'existait plus. On a mangé une soupe de poisson sur une aire d'autoroute, enfin d'autoroute... C'était super bon, il y avait une tête de bar avec de grands yeux qui flottait dans mon bol. »
Puis c’est Paris, toutes ses lumières, la tour Eiffel, le Sacré cœur, Pigalle… « Non, je n'ai rien vu de Paris à ce moment-là, coupe Gleb. On a fait une pause dans un parking souterrain avant de repartir. Je me rappelle juste qu'en allant aux toilettes, j'ai vu une pile de magazines féminins gratuits. J'avais douze ans, il y avait des femmes à poil... Je n'ai pas pu résister, j'en ai pris un. J'avais l'impression de voler une pomme, c'était très bizarre pour moi, un magazine gratuit, en couleurs en plus! Ça a été un choc. » L’exode se poursuit. La destination finale se trouve à quelque 200 kilomètres d'ici, sur les bords de la Manche, en Haute-Normandie, au Havre.
Un havre de paix ?
Environ 4 000 kilomètres séparent Grozny du Havre. Deux villes qui n'ont probablement pas grand-chose en commun, si ce n'est qu’elles ont été toutes deux rasées pendant la guerre. « On a débarqué là, dans le quartier des Neiges, ça valait bien le coup de partir de Russie », se marre Gleb. « Au début, on était logé au foyer Sonacotra du quartier. Franchement, comparé aux foyers russes, c'était la belle vie. Il y avait plein de pièces collectives et surtout, il y avait un robinet et un frigo par chambre. C'était rare à l'époque, non ? »
Au Havre, Gleb commence à apprendre le français. « A l'époque je ne connaissais que deux mots : « pantalon » et « soleil ». Ah oui, et je répondais tout le temps « comme-ci comme-ça ». Mes professeurs avaient du travail! En plus, j'étais très mauvais élève donc j'apprenais dans la rue, dans la cour du collège ou avec les dealeurs du coin ».
Au foyer, l’adolescent côtoie des personnes venues du monde entier. « Je me souviens qu'au début, j'étais impressionné, confie-t-il. J'habitais dans le quartier des Neiges et pourtant, j'étais l’un des seuls flocons. Tous mes camarades étaient noirs ou arabes. Avant d'arriver au Havre, je n'en avais jamais vus! »
Gleb va passer de collège en collège avant de finir par trouver le bon. Il y reste jusqu'à obtenir le brevet, non sans difficultés. Gleb pense détenir, aujourd’hui encore, le record de fautes d'orthographe à l'épreuve de dictée de français : « cent fautes, qui dit mieux ? », demande-t-il, hilare. « Mais j'étais heureux, à cette époque. Pour la première fois de mon existence, j'avais une vie stable dans un endroit stable. C'est précieux. Et j'avais de vrais amis. »
L’enfer parisien
Cette précieuse accalmie dans la tempête de sa vie est de courte durée. Gleb échoue au lycée et décide, avec son père, de partir pour Paris afin de trouver du boulot. Il a dix-huit ans. L’objectif est double : gagner de l'argent et obtenir la nationalité française. Pendant quelques mois, le jeune homme fait du gardiennage en apprenant à devenir parisien, dans une ville réputée pour rejeter les moins tenaces.
« Mon père a quitté Paris et je suis resté tout seul, dit Gleb. Pour payer moins cher, j'ai trouvé un treize mètres carré à trois. Une grand-mère, sa petite-fille et moi. Rapidement, j'ai compris que la famille voulait que je me marie avec leur fille afin d'obtenir des papiers ou je ne sais quoi. J'ai refusé… Ils m'ont viré et je me suis retrouvé à la rue. »
« Je n’avais pas beaucoup d'affaires. Il fallait que je sois mobile, alors j'ai décidé de me séparer de la plupart de mes effets. Je savais que ça durerait longtemps, je le sentais… Très vite, j'ai préféré ne pas me mélanger aux autres SDF. Chacun son histoire, chacun sa merde, tu peux pas t'encombrer des gens si tu veux t'en sortir, tu dois être égoïste. Une journée dans la rue équivaut à cinq dans la vraie vie. Je passais mes journées à chercher des aides et à tenter d'obtenir la nationalité française, et mes nuits à essayer de dormir au calme. J'étais partout. Dans les parcs, dans les voitures abandonnées, dans les transports en commun, sous les ponts, je craignais les autres, alors j'étais inventif et je bougeais tout le temps. Mon meilleur spot, c'était sur l'île de Puteaux. »
Gleb roule une autre cigarette. Son discours s’égare, tandis que des enfants jouent autour de lui, comme le font des centaines d’enfants aux Buttes Chaumont, à Paris, chaque dimanche après-midi. « C'est sur l'île de Puteaux que j'ai rencontré celui qui m'a tout appris de la rue, reprend le jeune homme. Je n'ai jamais connu son nom. Il parlait quatre langues, je n'en connaissais aucune, mais on se comprenait », explique Gleb, l’air soudain rêveur. « Il m'a appris à construire mon premier réchaud. C'était rudimentaire mais très efficace. Je pouvais enfin boire mon thé et mon café le matin pour me réchauffer ».
« Est naturalisé(e) Français(e) : KHASSOUEV Gleb »
A la croisée des chemins, Gleb est tenté d’abandonner. « C'est une chance, je ne tiens pas l'alcool! Ça m'a évité de plonger complètement quand j'étais à la rue », lâche-t-il, un joint aux lèvres. Gleb organise ainsi ses journées du mieux qu’il peut, toujours en quête de son identité. Il enchaîne les jobs à droite et à gauche. « J'avais quelques boulots au noir », détaille-t-il. « Des gens te voient zoner et ils viennent te proposer du taf juste à ta gueule. C'est du délit de faciès inversé. On te donne du travail parce que t'as une tête d'étranger. Mais bon, en vrai, ils t'arnaquent. Tu prends ce que tu peux et tu pars. Tu survis une semaine de plus. Je n'ai jamais voulu faire la manche ou voler. Je voulais acheter ce que je mangeais. »
Le reste du temps, Gleb tente de dompter l'administration française. Il passe de commissariat en commissariat et de centre d'accueil en centre d’accueil pour essayer de régulariser sa situation. L'objectif est clair : obtenir la nationalité française.
« La plus grande difficulté pour moi, c'était d'être présentable, propre. Au fil des semaines, c'était de plus en plus difficile. Progressivement, le regard des autres m'a fait comprendre que j'étais déjà ailleurs. » De temps à autre cependant, Gleb tombe sur quelqu’un qui va l’aider, pour une douche, une nuit ou un repas. « Quand tu reçois une convocation, tu passes des entretiens sur un ou plusieurs jours. Là, il ne faut pas te rater. Puis, tu attends à nouveau. J'étais épuisé. J'avais le papier rose (titre de séjour) qui te permet de rester dix ans, pas un jour de plus. Bon, le papier rose c'est toujours mieux que le papier jaune avec les trous sur les côtés, mais j'espérais le papier bleu. Je ne voulais plus d'épée de Damoclès sur la tête. Je ne voulais plus exister à moitié, je ne voulais plus être réfugié. Je voulais devenir citoyen français. »
Au total, Gleb passera six mois dans la rue à écumer les administrations et à dormir sous les ponts. Jusqu’au jour où il reçoit un courrier chez un ami. Il décachète l’enveloppe : entre la Déclaration des Droits de l'Homme et la Marseillaise, une feuille cartonnée format A4 retient toute son attention. Dessus, il est écrit sobrement : Est naturalisé(e) Français(e) : KHASSOUEV Gleb, né le 23/01/1988 à Grozny, Russie (U.R.S.S.).
« Quand je l'ai eue, ça a été très fort », dit-il, des étoiles dans les yeux. « J'étais un vagabond, je prenais enfin racines. J'étais sous la protection de l'Etat français. Et ça, c'est très important. Quand tu reçois la carte d'identité française, tu deviens un individu à part entière qui a quelque chose à apporter à cette société. J'étais stabilisé, ancré. La première chose que j'ai faite ? J'ai pris un train pour Le Havre et j'ai fait la fête avec mes amis. J'ai porté un toast et brandi ma nouvelle carte d'identité. Personne n'était au courant, ça a été un hurlement de joie. Tout le monde m'a offert un verre. Je ne tiens pas l'alcool, étonnant pour un Russe pas vrai ? J'ai dû boire avec tout le monde et la fête n’a duré que trente minutes pour moi : j’ai vomi toute la nuit. J'étais tellement heureux. »
Pour quelques tasses de thé...
Un bonheur n'arrivant jamais seul, la suite confine au conte de fées. Alors qu’il est français depuis peu et qu'il vit toujours dehors, Gleb se promène un soir dans Paris en compagnie de deux amis. Les trois camarades tombent sur deux filles avec qui il pourront partager leur nuit d'ivresse. Gleb remarque l'une d'entre elles. « Je ne lui adresse pratiquement pas la parole ce soir-là, se rappelle-t-il. Mais elle m'impressionne. Elle est intelligente et elle a le sourire généreux. Je me dis : il faut absolument que je la revois ». Le lendemain, Gleb lui envoie un message. Elle accepte de le rencontrer à nouveau. Pendant trois jours, ils ne se lâchent pas, à tel point qu'elle lui propose de venir vivre chez elle alors que, quelques heures auparavant, il dormait encore sur son île. Ils ne se sont plus quittés depuis. « Le premier soir chez elle, j'ai dû boire sept ou huit tasses de thé. Elle m'en proposait une, puis une autre, puis encore une autre. C'était une manière de me faire rester. Dix ans ont passé, j'y suis encore ».
A cette époque, Gleb enchaîne les CDD. Quatre mois par-ci, six mois par-là. Dans le commerce, la restauration, le bâtiment, le démarchage, l'étude téléphonique, l’audiovisuel, les écoles, le gardiennage. « La plupart des gens qui viennent conquérir Paris passent par plein de petits boulots. C'est un parcours classique finalement, réfugié ou non, français ou non. Beaucoup de gens se font avoir. Paris, c'est une ville difficile. N'ayant pas de diplôme, j'ai fait tous les métiers qu'on me proposait », résume Gleb.
Et puis, un jour, alors qu'il a lui-même oublié avoir fait cette démarche, les éboueurs de Paris le contactent. Sa candidature a été retenue. « J'ai passé une batterie de tests. On était 1 500 dans une salle, les trois quarts ont sauté. Et j'ai été pris. Ça fait maintenant quatre ans que je travaille là-bas. J'ai finalement trouvé ma stabilité. Enfin. » Il sourit. Dans le parc des Buttes Chaumont, il n'y a plus grand-monde. La conversation a duré près de trois heures. La nuit tombe, les gardiens demandent à tout le monde de partir.
Qui suis-je ?
L’entrevue se poursuit chez Gleb, une tasse de thé à la main. L'appartement est petit mais du balcon, on aperçoit la tour Eiffel. La question identitaire est quelque chose qui taraude Gleb : « En réalité, je suis plus français que les Français eux-mêmes, dans le sens où j'ai choisi de le devenir », déclare le jeune homme. « Derrière ma nouvelle nationalité, il y a du mérite et ça j'en suis fier. Pour moi, être français, c'est avoir conscience que l’on est un individu avant toute chose et que l’on a envie de revendiquer son individualité. » Et en Russie, alors ? « Là-bas, tu vis pour toi mais une certaine idée du collectif prime. Tu es un rouage du patriotisme russe construit par le pouvoir russe et la foi orthodoxe. » Qui est vraiment Gleb ? Partagé entre ces deux parts de lui-même ? « Moi ? Chaque nationalité prendra le dessus quand il le faudra, mais une chose est sûre, je suis un enfant de la Russie pour qui son pays est devenu étranger. » Il y a bien un regret : « Le craquement des pas dans la neige quand il faisait très froid, ça, ça me manque. »