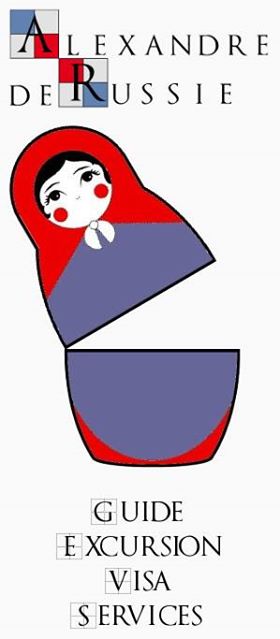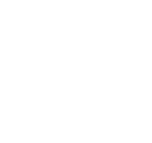Va-t-on en vacances en Ouzbékistan ? (7)
Septième partie
Je sais, il faudrait arrêter de parler nourriture, mais les voyages ont une fâcheuse tendance à nous ramener à notre humaine et triviale condition. Privés de notre ancrage quotidien, nous sommes livrés aux aléas du transit, qu’il soit intestinal ou ferroviaire. Aussi se doit-on parfois de prendre les choses en main pour élever le débat, retrouver un peu de hauteur, et admirer les produits les plus spirituels de notre humanité (sans penser au même moment à nos pieds douloureux ou au prochain repas). Qu’à cela ne tienne, la journée du 7 mai sera culturelle ou ne sera pas, et je m’arme de mon calepin fétiche pour noter quelques informations capitales sur le Régistan, en espérant que ma mémoire sélective – fâcheuse tendance à retenir les variations de température et les degrés variables de l’ennui – sera pour une fois à la mesure de l’effort fourni. Résolue à ne plus prendre une médersa pour une autre (même si, quand même, quand on y pense, il y a de quoi se gourer…), je m’applique à faire le croquis de l’ensemble monumental qui fait la gloire de Samarcande, tout en inscrivant consciencieusement au bas de la page la traduction arabe des termes récurrents, parmi lesquels je retiendrai le pichtak (portique) ou encore le mihrab, désignant le mur de la mosquée qui donne sur la Mecque.
Alors, résumons : à ma gauche, la médersa construite au XVè siècle par Oulough Beg – attends, c’est qui lui, déjà ? Ah oui, le petit-fils futé de Tamerlan, qui profita des conquêtes faramineuses de son grand-père pour passer ses trente-huit ans de règne à sonder les astres depuis son observatoire, avant de livrer malgré tout quelques batailles pour avoir la paix. Deux cents ans plus tard, ayant le goût de la symétrie, un certain Yalangtouch décide de bâtir, en miroir avec la précédente, la médersa Cher-Dor (« qui porte des lions »). Bon sang, mais c’est bien sûr, quoi de plus remarquable que ces lions dorés surplombés d’un œil au milieu duquel figure un visage, je les vois en haut du pichtak comme le nez au milieu de la figure, justement, et je me réjouis d’avoir repéré cette image aux vertus mnémotechniques. Bien sûr, je pourrais aussi essayer de mémoriser la maxime de Yalangtouch qui orne les arcades de Cher-Dor (en arabe), mais je me contenterai d’en calligraphier la version française : « L’acrobate de la pensée grimpant à la corde de l’imagination n’atteindra jamais les sommets interdits des minarets. » Ça philosophe sérieusement, du temps des sultans érudits, mais ce n’est pas une raison pour rester les bras ballants : le même Yalangtouch, qui n’entendait pas se contenter de la symétrie architecturale, voulait aussi fermer l’espace de façon harmonieuse, ce qui le conduisit à faire construire la troisième médersa. On peut le dire, il avait un sacré coup d’œil.
Nous poursuivons notre découverte culturelle de Samarcande en montant vers la nécropole Chah-i-Zinda. Expiant nos fautes diverses sous le soleil de midi, nous nous voyons dans l’obligation de longer puis de traverser une sorte de périphérique pour accéder à ce lieu saint, qui grouille de pèlerins ouzbeks et de touristes de toutes nationalités. Nous nous voilons la tête pudiquement, nous apprêtant à parcourir ce chapelet de mausolées avec la plus grande déférence, mais l’ambiance n’est pas vraiment au recueillement. On fait la queue pour entrer dans les tombeaux, les jambes nues des jeunes filles russes se mêlent aux foulards colorés des autochtones, et l’on grimpe la colline dans un caquètement discret mais certain. Déjà vaincue par le zénith, ayant grillé mes cartouches d’enthousiasme touristique au pied du Régistan, je me borne désormais à constater le raffinement croissant de motifs familiers, tout en prenant note de l’accentuation des bleus, qui deviennent aussi durs que celui du ciel. Nous terminons la visite en errant dans le cimetière moderne qui surplombe la superbe allée des morts, parmi les pierres tombales noires sur lesquelles sont curieusement imprimées les photos des défunts. Le calme soudain, la laideur soviétique de ces stèles, et la sobriété quasi japonaise qui en résulte me ramènent à l’esprit des lieux – après tout, peu importe qui est enterré ici, l’important est de marcher en silence. Nous passons le reste de la journée à traîner un peu, grignotant à quinze heures les restes du petit déjeuner pantagruélique servi par notre hôtesse, cochant à dix-sept heures la dernière case touristique de la ville (le mausolée Gur-e-Amir, aperçu lors de notre arrivée, que Claire ne prend même plus la peine de photographier tant il a un air de déjà-vu), puis nous nous couchons avec les poules et – pour ma part – le dernier roman de Maylis de Kerangal, après avoir terminé celui de Maalouf.
Demain est un autre jour, comme chacun sait, et nous avons décidé de varier les plaisirs en souscrivant à l’option « trek » proposée par le guide intrusif mais commercial que nous avons rencontré à Khiva. Tout en insistant lourdement sur la bonne affaire que nous faisons en lui donnant 80 euros pour la journée, ce dernier nous jette dans une voiture qui est peut-être la sienne, conduite par un vieil homme peu causant (son père à la retraite ?). Oubliées, les folles accélérations du tacot de Boukhara ! Nous roulons le plus tranquillement du monde. Une heure plus tard, notre papy flegmatique s’arrête au village de Tépakoul, nous confie deux bouteilles d’eau et un pique-nique, puis s’installe chez celui qui va nous servir de guide pour passer une journée très cool à côté de la théière. Nous emboîtons alors le pas à un quinquagénaire buriné, auquel son accoutrement (jean-baskets-casquette) et son allure souple donnent un air de jeune homme. Il se charge distraitement des bouteilles que nous sommes ravies de ne pas porter, et nous entraîne vers la montagne après nous avoir demandé combien d’heures nous voulons marcher (six ! On veut transpirer !). Le russe n’est pas plus son fort que le mien, mais je parviens toutefois à comprendre que notre micro-randonnée constitue un extra financier non négligeable dans sa vie de berger père de quatre enfants. Il a aussi dix frères et sœurs, qu’il salue au lointain (« Tiens, sur le versant opposé, mon neveu ! », « Là, au fond, la maison de mon oncle ! »), ce qui donne l’impression sympathique que toute la vallée leur appartient. Celle-ci est d’ailleurs délicieusement variée, tantôt rocailleuse, tantôt ombragée, et la cascade au pied de laquelle nous engloutissons nos sandwiches vient parfaire ce cadre champêtre. Seule ombre au tableau : il s’avère que notre guide a consciencieusement rangé les bouteilles d’eau… dans son propre frigidaire, ce qui nous pousse à prendre le risque de boire l’eau du torrent (Ah, tourista, quand tu nous guettes !). Le frisson de l’aventure nous gagne, alors que nous trébuchons dans la descente (pas de sentiers balisés, bien entendu), tout en raisonnant sur les normes de sécurité en vigueur chez nous (l’UCPA n’est pas encore passée par là). Mission accomplie : en cinq heures de marche rapide, sous le soleil et sans eau, nous voilà cuites, rassérénées, bonnes pour une soirée à ne rien faire sans en éprouver le moindre regret.
Suite et fin la semaine prochaine...