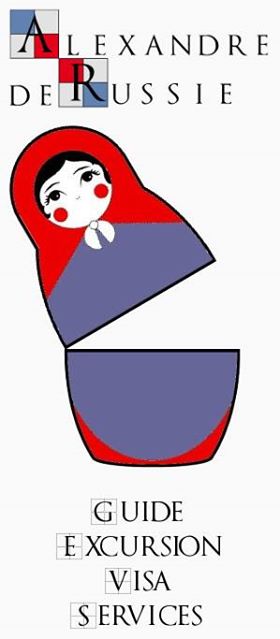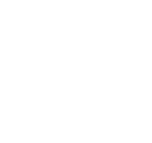Va-t-on en vacances en Ouzbékistan ? (6)
Sixième partie
Dans le centre historique du vieux Boukhara, l’impressionnante façade de la médersa Mir-i-Arab fait face à la mosquée Kalon, flanquée d’un minaret d’une telle hauteur que le vieux Gengis, enfin calmé dans ses ardeurs destructrices, a renoncé à l’abattre. Nous nous asseyons dans son ombre et nous contemplons cette cheminée de 47 mètres de haut, enduite des pieds jusqu’à la tête de petites tuiles bleue turquoise (avec les variations de ton qu’on a appris à connaître depuis Khiva), tout en méditant sur les prouesses technologiques des ingénieurs du temps passé – et sur la façon dont nous allons pouvoir passer le temps d’ici la fin de la journée.
J’ouvre ici une parenthèse sur le rapport complexe que j’entretiens avec les voyages, dont je suis boulimique et pourtant peu souvent satisfaite, car j’oscille entre la déception (les gens sont tous pareils, où qu’on aille), l’ennui (un temple, ça va, mais dix temples identiques, ça lasse), le désœuvrement (que faire entre les dix temples et le dîner, quand on loge dans une mauvaise auberge ?), la fatigue (se promener en ville, ça use, prendre un bus chaotique, ça épuise), voire l’écœurement (berk, ce plat local est immangeable). Bref, je suis une très mauvaise voyageuse, peut-être parce que rien ne vaut pour moi le voyage réduit à sa plus simple expression, une bonne marche à pieds de huit heures au terme de laquelle je suis agréablement lassée, usée, épuisée, mais je m’étonne moi-même de me voir repartir toujours pour de nouvelles destinations, alors que toutes mes expériences passées me poussent à ne plus tenter le diable. Alors voilà, est-ce la rêverie qui précède ou celle qui suit le voyage, les petits bonheurs qui jettent de doux éclairs sur des journées languissantes, une bonne table alors qu’on avait très faim, un lit douillet là où l’on s’attendait à un pucier, toujours est-il que je suis incurable, j’ai le vice voyageur dans la peau. Pour ce qui est de l’Ouzbékistan, je dois avouer par ailleurs qu’une de mes motivations premières résidait dans l’idée de goûter à la chaleur estivale à une période où Moscou ne connaîtrait encore qu’un frais printemps – là aussi, j’ai été déçue puisque j’ai quitté un merveilleux début d’été moscovite (dès le premier mai) pour une fournaise ouzbèke dont je me serais bien passée.
Et c’est dans ce brasier que nous nous apprêtons à terminer notre visite de Boukhara, alors que nous grimpons en plein midi les marches de la forteresse de l’Ark, où le khan tenait audience à ciel ouvert tout en surveillant du coin de l’œil les envahisseurs potentiels. La résidence fortifiée est désormais déserte, et quelques touristes se battent en duel sans s’attarder, pour revenir dans les artères plus animées de ce qui fut un jour la capitale de la région. Il est cinq heures, et l’animation se limite désormais à quelques marchands de céramiques qui s’éventent nonchalamment, tout en interpelant aussi paresseusement les rares passants qui ont résisté à la chaleur. De notre côté, nous échouons dans ce qui ressemble à l’unique café bobo de la grand’ place, petite échoppe vaguement climatisée tenue par une Allemande d’une cinquantaine d’années. Il y a toujours quelque part, au fin fond de l’Ouzbékistan, de l’Inde, ou même d’une petite province espagnole, quelques gens du Nord (souvent des Hollandais, mais l’Allemagne se défend bien) qui adorent voyager, ouvrir des maisons d’hôte bio, proposer des repas conviviaux avec formule méditation incluse, et qui ont tout compris aux plaisirs de l’Occidental exilé en terre exotique : un sandwiche qui ressemble à quelque chose, un vrai café qui embaume, un accueil amical et bilingue, voire une conversation qui vous relie soudain à un univers doucement familier. Amoureux naïfs de l’humanité, ces aventuriers généreux et modérés à la fois ne cessent de m’étonner et de me réjouir, quand ils n’éveillent pas en moi une soudaine vocation hôtelière à l’autre bout du monde – mais c’est sans regret que je laisserai notre Allemande au sort qu’elle a choisi, à l’ennui, à l’hiver ouzbek et aux touristes de passage.
Samarcande nous attend. Inutile de risquer notre vie une deuxième fois dans un remake de Taxi II, nous misons sur le réseau ferroviaire, ce vestige encore vaillant de l’époque soviétique. Embarquement de bon matin à bord d’une sorte de train corail tout à fait plaisant : une brise fraîche le traverse, les passagers sont d’un calme aussi olympien que ceux de Tachkent (bébés compris), et une petite responsable de wagon propose des verres de thé à la menthe. Il n’en faut pas plus pour nous assoupir, mais le cauchemar de la modernité nous arrache soudain à ces prémices de bonheur – des écrans plats jusque là anodins se mettent à diffuser à grands cris un film petit budget dont il n’est pas difficile de saisir les moments clé. Parmi les scènes notables, une rencontre amoureuse autour d’un piano (image : doigts effleurés ; son : soupe classique André-Rieusienne), un secret de famille visiblement éventé (image : héros en transe ; son : cri déchirant, façon pleureuses orientales), mort d’un enfant, bagarre entre hommes (pleeease, baissez-le son, je vais crever). La lecture de Samarcande d’Amin Maalouf, roman qui surfe sur la couleur locale et la fresque historique avec plus de brio que les pages culturelles du Lonely, me permet heureusement de me retrancher dans mon fort intérieur, loin de ces agressions cinématographiques.
Ouf, nous voilà arrivées ! La gare est située à neuf kilomètres du centre ville, même s’il apparaît rapidement que la notion de centre s’applique mal à l’urbanisme hétéroclite qui caractérise ce point névralgique de la route de la Soie. De grandes avenues aérées et bordées de vieux arbres séparent des « quartiers » qu’on peine à identifier comme tels. Autour des monuments historiques, dispersés dans la ville sans logique apparente, de vastes zones dégagées, aux pelouses minutieusement entretenues ; non loin de là, des dédales de petites rues inégalement pavées et dans lesquelles on tombe presque par hasard, comme si elles avaient été oubliées au sein du programme de rénovation citadine. Nous découvrons ainsi que la maison d’hôte où nous avons élu domicile, pompeusement appelée « Timur the Great », se situe au cœur d’un ancien quartier juif qui se réveille au coucher du soleil, à l’heure où sortent les femmes, les enfants, et les chiens. A quelques centaines de mètres de là s’ouvre en contrebas l’esplanade du mausolée Gur-e-Amir (tombe de Timur, appelé aussi Tamerlan), le long duquel se déroule une enceinte couverte de majoliques bleues et blanches. A l’intérieur, nouvelles rues minuscules et calmes, alignant de petites maisons centrées sur des cours qui laissent entrevoir des vies de famille paisibles, et des siècles de bon voisinage. Munies d’une adresse léguée par un ami moscovite, nous finissons par trouver la personne qui a eu la bonne idée d’ouvrir un B&B dans ce havre de paix, et qui propose un menu délicat concocté à demeure. Premier vrai léchage de babines depuis le début de notre voyage : l’éternelle salade concombres-tomates est agrémentée d’une sauce à base de yaourt (quelle folie !), le chou-fleur est mariné (quelle audace !), et le mouton du plov (toujours huileux) s’avère particulièrement goûtu. Nous ne savons pas encore que c’est la dernière fois que nous dînerons ainsi, à nous en faire péter la panse.