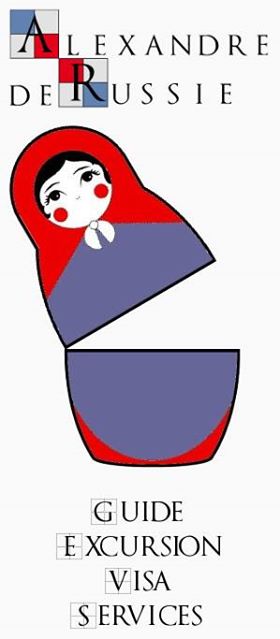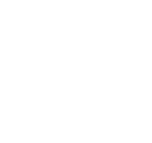Va-t-on en vacances en Ouzbékistan ? (2)
Deuxième partie
Deux heures après l’atterrissage, me voilà donc à la gare de Tachkent où je cherche Claire en vain, jusqu’à ce qu’un charmant jeune homme, persistant à me parler dans un anglais à peine compréhensible alors que je le questionne dans mon russe à peine moins rudimentaire (chacun de nous désirant pratiquer sa langue étrangère), m’indique l’existence d’un hall de gare voisin. Je retrouve Claire devant les caisses de la gare, les poches, les chaussures et le soutien-gorge lestés de billets comme un faux-monnayeur, car elle a pris l’audacieux parti de changer 150 euros sans savoir que la monnaie locale allait nous être délivrée en billets de mille sums (et même de 500). Sachant qu’un euro vaut 3 000 sums, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi tout un chacun en Ouzbékistan, ou à Tachkent du moins, se promène en ville avec des liasses de billets unis par des élastiques et rangés dans une vieille pochette en plastique, liasses qu’il faut savoir recompter d’une main experte – balayer les billets du bout de l’index, dans un mouvement coulant qui ne nécessite heureusement pas de mouiller le doigt pour plus de fluidité.
Fortes des témoignages divers selon lesquels il n’y a absolument rien à faire ou voir à Tachkent (l’expérience prouvera plus tard le contraire), nous avons décidé de quitter la ville le plus vite possible. Le Ciel nous sourit : un train de nuit part dans la demi-heure pour Urgench, ville située non loin de Khiva, et nous nous réjouissons de cette première réussite en termes d’organisation, puisque nous rationnalisons notre trajet en partant du point le plus éloigné de la capitale pour y revenir progressivement, logique qu’une première étape à Samarcande aurait définitivement ruinée. Après nous être débarrassées de quelques liasses (imaginez-vous payer un billet de train en pièces de 50 centimes d’euro, et vous aurez l’effet), nous courons, échevelées, vers les quais, où une foule compacte et colorée attend patiemment l’arrivée du train. A la sortie de l’escalier, l’étonnement est réciproque : d’un côté, deux ovnis avec leur maison sur le dos, figures pâlottes et suantes ; de l’autre, un rassemblement de familles dont le calme et la tenue impressionnent. Nouveau préjugé – la foule bruyante et pouilleuse des pays en voie de développement – battu en brèche : les hommes sont dans l’ensemble élégants, vêtus de jeans bien coupés et d’une chemise raccord, les femmes âgées portent de jolis costumes traditionnels brodés, et tout ce beau monde n’aura de cesse d’organiser un petit ballet devant les toilettes du wagon pour garder sa fraîcheur jusqu’au matin.
Nous grimpons dans notre « coupé » (wagon 2nde classe construit sur le modèle russe), et j’éprouve aussitôt un sentiment agréable de familiarité à retrouver la petite vie du train, moi qui connais la version « platzkart » du transsibérien (3è classe, Moscou-Irkutsk en quatre jours et demi). Même samovar au fond du couloir, même impression de recréer en deux temps trois mouvements son petit chez-soi avec ses camarades de compartiment, en l’occurrence un couple d’une cinquantaine d’années accompagné d’une petite fille. L’homme est bavard, curieux, content de pouvoir discuter en russe avec nous, c’est-à-dire d’établir une drôle de conversation qui consiste à bombarder Claire de questions (sachant très bien qu’elle ne parle pas un mot de russe), tandis que je réponds à sa place en la désignant à la troisième personne. Nous n’échappons pas à LA question par excellence (notre âge), qui constitue visiblement la pierre d’angle de tout dialogue avec l’autochtone, ce dernier ne pouvant que s’étonner de voir deux femmes relativement âgées (38 et 34 ans) vadrouiller seules et sans alliance dans ce pays où l’on est casé à vingt ans – comme en Russie, d’ailleurs. Heureusement, tout n’est pas perdu pour Claire qui, d’après l’homme du train, a l’air d’avoir dix-neuf ans, mais j’aurai davantage de raisons de m’inquiéter lorsqu’un jeune Ouzbek me demandera quelques jours plus tard si Claire n’est pas ma fille. Je choisis de m’esclaffer.
Avant de prendre le transsibérien, j’avais parcouru les blogs de voyageurs avertis pour savoir comment survivre à bord d’un train qu’on ne quitte pas pendant quatre jours et demi, pourvu d’un samovar dont les braises sont entretenues continuellement par les deux chefs de wagon. Grâce à ces vestales du rail, dont l’autre mission est de verrouiller les toilettes vingt minutes avant et après les arrêts en gare, ce qui provoque des exercices récurrents de contention de la vessie, il est possible de s’alimenter à partir d’un stock de soupes lyophilisées, de bols de nouilles chinoises, le tout noyé dans un flot de thé. A quai, on complète ces repas déshydratés en achetant des concombres, des tomates et des fraises des bois à de petites dames ridées comme des vieilles pommes, produits fraîcheur vendus en vrac dans des seaux où ils croupissent au soleil. Pour l’heure, ayant embarqué à la dernière minute pour un jour et demi de trajet, nous n’avons pas prévu le kit de survie Knorr, et notre dîner, qui se résume à grignoter des fruits secs en buvant de l’eau, prend une note frugale qui caractérisera l’ensemble du voyage. Inconvénient de ce repas diurétique, il me faut descendre en pleine nuit du perchoir sans échelle (couchette du haut), en essayant de ne pas tomber sur la fillette que ses parents ont casée à même le sol. Damned ! Arrêt du train en gare ! Je dois patienter devant la porte des toilettes avec un nouvel amateur de pratique linguistique, qui finit par abandonner son anglais chaotique pour me demander en russe si je ne suis pas architecte. Je ne sais pas pourquoi mais ça me fait rire, et lui aussi, qui me quitte en me tapant dans la main à l’américaine.
A six heures du matin, le chef du wagon ouvre les portes du compartiment comme si on était au pensionnat, en criant Salam aleykoum ! sur le ton de « Debout là-dedans ! », ce qui pourrait être irritant sachant qu’il nous reste encore quelque sept heures de train à nous farcir. Mais il fait beau, et mes voisins du dessous m’offrent du thé vert, auquel j’ajoute les gâteaux secs que nous avons tout de même eu la présence d’esprit d’acheter sur le quai : rien de tel qu’une bonne dalle pour apprécier ce petit déjeuner ascétique. Je me rallonge sur ma couchette, bercée par le roulis, caressée par un petit vent frais, et tandis que la fillette fait hurler une musique orientale tout en quart de tons sur le téléphone de ses parents, je regarde défiler un paysage interminable de steppe brûlée et de gazon en voie d’extinction.