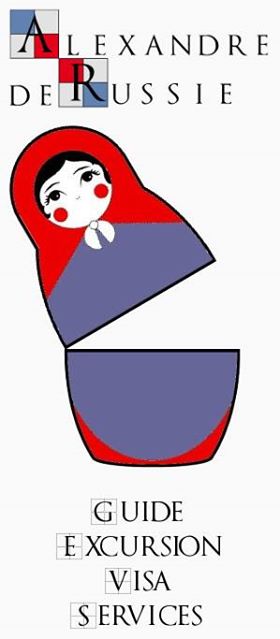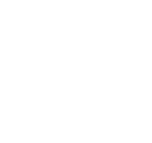Le patrimoine soviétique, reflet de l'utopie communiste
En Russie, l'URSS est à la mode. On y voit ressurgir des statues de Staline, s'y développer un tourisme soviétique tandis que quelques autres pratiquent l’urbex au milieu des ruines du dernier empire que le monde ait connu. Julie Deschepper est doctorante à l’Inalco : elle décortique pour nous l'état du patrimoine soviétique dans la Russie d’aujourd’hui. Entretien.
La Dame de Pique : Julie Deschepper, vous êtes doctorante à l’Inalco et travaillez sur la mise en patrimoine des monuments et de l’architecture soviétique de la révolution d’octobre 1917 à nos jours. En quoi cela consiste-t-il ?
Julie Deschepper : Il s’agit d’un travail sur le temps long qui s'inscrit à la croisée de l'histoire culturelle de l'URSS et des études sur le patrimoine, selon un courant que l’on appelle « critical heritage studies ». Je pourrais résumer les enjeux de ma thèse en trois points. D'une part, il existait une conception véritablement soviétique du patrimoine, différente de celle qui a pu exister dans le monde occidental ou plutôt européen. D'autre part, cette conception du patrimoine est intimement liée au rapport au temps et à l'espace promu par le socialisme en lui-même et cela a pu se diffuser dans d'autres régimes socialistes. Enfin, le patrimoine et la mise en patrimoine des productions architecturales monumentales de l'État soviétique ont joué un rôle extrêmement important dans sa légitimation mais aussi dans sa construction et dans sa perpétuation. Ce sont les trois grands points sur lesquels je travaille. Chronologiquement, mon travail s'étend jusqu'à la période contemporaine, j'étudie le devenir de certains bâtiments à travers trois grands cas d'étude pour en comprendre l'évolution depuis leur création jusqu'à nos jours.
LDDP : Quelles sont les représentations russes du patrimoine ?
JD : En russe, le mot patrimoine est difficilement traduisible. Depuis les années 1960-70, on utilise le terme de « культурное наследие », ce qui signifie « patrimoine culturel » en russe. Mais avant cela, on utilisait l'expression « памятники истории и культуры », c’est-à-dire « monuments de l'histoire et de la culture ». Ce qui renvoie aussi à toute la charge que représentaient ces bâtiments. Ça peut paraître anecdotique mais ça me semble quand même important.

À Volgograd, le passé soviétique est mis à l'honneur (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Aujourd’hui, quand on se promène en Russie, dans n'importe quelle ville russe, ce qui frappe souvent le touriste ce sont évidemment tous ces bâtiments soviétiques abandonnés. Aussi, la question que l’on peut se poser est la suivante : est-ce qu'il y a un programme en Russie de sauvegarde de ces bâtiments ? Pourquoi bon nombre de ces bâtiments ne sont pas protégés ? Est-ce que finalement ce ne serait pas le signe d'un désamour de la population russe pour son patrimoine soviétique ?
JD : Alors c'est une question assez large. Et moi au contraire, ce qui me frappe davantage, ce n’est pas l’abandon, c'est plutôt l'éclectisme de ce patrimoine – avant même de s'intéresser peut-être à l'état des bâtiments. Ce qui me frappe encore, c'est la grande richesse et la diversité des tailles, des couleurs, des strates historiques qui sont représentées en Russie. C'est véritablement fascinant. C'est d'ailleurs cette représentation de l'histoire en plein jour, ce véritable musée à ciel ouvert, qui m'a poussée à m'intéresser à la question du bâti, de ce qui est visible dans l'espace public. Après, la question de la conservation de ces bâtiments ou des monuments recouvre plusieurs enjeux qui sont en fait les mêmes pour le reste du monde. D'un coté, des questions très pratiques, financières et légales. Qui est en charge du maintien de ces bâtiments ? Si l’on se concentre uniquement sur l'architecture, qui est en charge de les maintenir en vie ? Cela dépend du propriétaire bien entendu et donc de ses prérogatives. D'un point de vue légal, il s'agit de savoir si le bâtiment est classé au titre du patrimoine. Donc en fonction de leur statut légal, le type de restauration, le type de conservation à mettre en œuvre dans une certaine temporalité n'est pas du tout le même. C'est un premier point auquel j'ajouterais la fonction du bâtiment : est-il habité ou non ? Est-ce un bâtiment public, est-ce au contraire un bâtiment privé ? Il y a tout un tas de pratiques à prendre en compte. De plus, il y a les problématiques liées aux représentations. Est-ce que ce bâtiment est apprécié ? Rejeté ? Si oui ou non, pourquoi ? Quelle image de la Russie renvoie-t-il ? Quelle histoire incarne-t-il ? Pour qui et pourquoi ? En fait, dans ces volets d'interrogations, il y a des enjeux parfois tout à fait contradictoires et les acteurs convoqués ne sont pas du tout les mêmes. Il arrive que les autorités veuillent conserver certains bâtiments alors qu'une partie de la population va s'y opposer. Il faut toujours composer avec cela pour comprendre l'état actuel de ces bâtiments. Sans compter qu’en Russie, la situation est complexe parce qu'il y a des problèmes d'application de la loi et de corruption. Enfin, il y a une évolution extrêmement rapide et brutale des représentations qui sont associées aux monuments puisque l'histoire soviétique qu'ils incarnent a subi des évolutions très fermes ces dernières décennies.
LDDP : Alors justement, ce que vous dites est très intéressant car on touche du doigt le rapport à la mémoire en Russie aujourd’hui. Et c'est une problématique qui touche toute l'ex-URSS au regard de son passé soviétique. Par exemple, en Lettonie, le rapport aux bâtiments soviétiques est très clair et brutal, on est dans la destruction ou dans la muséification pour dénoncer la période soviétique. Tandis qu’en Russie, on a l'impression que de 1991 à aujourd’hui, il y a eu différentes époques de ce rapport à la mémoire. Les années 1990 représentent un moment de désamour à l'égard de ces bâtiments soviétiques et donc de ce passé récent. Alors que dans les années 2000, avec l'arrivée de Vladimir Poutine, on a assisté à un phénomène de retour, de réhabilitation de ce passé soviétique, et l’annexion de la Crimée intervient comme une forme de paroxysme de ce phénomène. La façon dont on traite un patrimoine permet-il de mieux comprendre l'évolution politique et culturelle d'un pays ?
JD : En fait, si on se concentre uniquement sur les bâtiments et même sur ce que nous appelons « patrimoine » - je vais clarifier cela dans un instant – il est vrai que c'est un outil parfait pour étudier le rapport à l'histoire, à la mémoire, l'évolution du passage du temps. C'est évidemment un outil incroyablement sensible pour travailler toutes ces questions-là. Le premier point qu'il faut absolument avoir en tête c'est que contrairement à l'idée reçue dominante, l'URSS a eu une politique de préservation de son patrimoine. Et si on se concentre uniquement sur le patrimoine architectural bâti et sur ses propres productions (ce qu'on appelle l'architecture soviétique), ces productions architecturales ont été considérées comme du patrimoine, classées légalement au titre de monuments de l'histoire et de la culture dans le courant des années 1970. Il y a plusieurs grands mouvements de patrimonialisations notamment en 1967, 1974, 1978, puis dans les années 1980 surtout à Moscou. Sachant que Moscou, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est la ville qui a eu le plus de réticences à protéger ses bâtiments. Il y a plusieurs facteurs à cela : cela tient au type d'experts qui faisaient partie de ces commissions, au nombre de monuments que cela concernait et donc aux implications financières et matérielles que cela impliquait. Bref, tout cela pour dire qu’aujourd'hui, quand on parle de patrimoine soviétique, il faut avoir en tête que légalement ce patrimoine était déjà considéré comme tel avant la chute de l’URSS. Ce qui ne correspond donc pas à la vision franco-française que l'on a du patrimoine, à savoir qu'une fois qu'une civilisation est close, tous ses objets matériels deviennent du patrimoine. Dans les faits, l'URSS a voulu et a mis en place une politique de conservation de ses biens architecturaux.

À Volgograd (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Et du coup, à quoi ces abandons visibles seraient dus ? À des négligences ? À un manque d'argent ?
JD : Dans les années 1990, ces objets ont changé de statut. Donc légalement, comme la Russie est l'héritière de l'URSS, les bâtiments ont conservé un statut patrimonial. En revanche, les représentations qui y sont associées ont évolué. Et là, on peut distinguer plusieurs types de patrimoines et plusieurs types de représentations. Les années 1990 ne sont pas non plus celles du rejet absolu de toute la période soviétique. Dans la première moitié des années 1990, effectivement, il y a eu rejet, un déni historique même. Au début, cela concernait la période stalinienne, puis cela s'est étendu à toute la période soviétique, dans la continuité de ce qui s'était passé sous Gorbatchev quand une grande partie de la période soviétique a été dénoncée. Par contre, dès les années 1990, on a commencé à récupérer des symboles patriotiques de l'époque soviétique. C'était une façon de reconstruire une identité nationale parce qu'on ne pouvait pas non plus nier ces longues années d'existence ! Il a fallu en tirer des éléments positifs, notamment autour de la Grande Guerre patriotique, de certaines victoires du peuple et des idées de grandeur de la Russie. À ce moment-là, on a déjà les ferments de ce qui va se passer plus tard, sous Vladimir Poutine.
LDDP : L'époque tsariste n’était-elle pas également remise au goût du jour dans les années 1990 ?
JD : Oui, d'un autre coté, on assistait aussi à une revalorisation de l'époque pré-révolutionnaire et de l'époque tsariste. On avait ces deux pendants-là. Et durant les années 1990, on a des représentations divergentes et évolutives du passé. Dans l'espace public, cela se matérialise concrètement par des destructions qui ont été largement médiatisées surtout en Occident : des statues de Lénine qui tombent, des déplacements d'objets symboliques, etc. Néanmoins, en réalité, il y a très peu de bâtiments totalement rasés par exemple, notamment pour le coût que cela implique. Mais aussi parce que la violence symbolique de la destruction d'un bâtiment est beaucoup plus forte parfois que celle, symbolique également, de déplacement ou de remplacement d'une statue. Donc on n'a pas assisté à de la destruction comme ça dans tous les sens, c'est complètement faux. En revanche, ces bâtiments ont souvent changé de fonction. Parce que à l'époque soviétique, ces bâtiments avaient un rôle à jouer dans la construction de la société. Donc des habitations qui étaient dédiées à la vie collective sont devenues des habitations dédiées à la vie individuelle, certains lieux administratifs ont gardé la même fonction ou alors ils en ont progressivement trouvée une nouvelle. Finalement, le fait qu'on transforme la fonction d'un bâtiment, ce n'est pas forcément une atteinte au patrimoine parce que, dans le fond, une transformation c'est une forme de revitalisation. Le bâtiment continue à vivre. Ce n'est pas forcément contradictoire.

La place Rouge, à Moscou, symbole du passé tsariste et soviétique (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Même quand l'une des Sept sœurs staliniennes est transformée en hôtel Radisson ?
JD : En réalité, ce qui nous choque ici et ce qui nous interroge, c'est le fait que des bâtiments dédiés à la construction du communisme soient aujourd'hui devenus des emblèmes du capitalisme. C'est ça qui nous frappe. Mais dans les faits, un bâtiment doit vivre, il doit vivre avec son temps. Donc si ça n'implique pas des destructions sur l'authenticité du bâtiment, sur les décors, les façades, les vitres, etc., pourquoi pas. A priori, ces changements de fonction ne sont pas nécessairement négatifs à mon sens. Après, il y a des théoriciens qui seraient beaucoup plus sévères là-dessus. Personnellement, je ne suis pas partisane de cela, surtout dans le cas de la Russie où un grand nombre d'anciens bâtiments soviétiques dominent l'espace public. Qu'est qu'on fait d'une cantine, une ancienne stalovaïa par exemple ? Est-ce qu'elle reste ainsi ? Dans une idée de nostalgie ? Ou est-ce qu'au contraire, on la transforme en un restaurant individuel en en gardant la forme ? Voilà, ça pose de vraies questions. Alors forcément, avec l'arrivée du capitalisme et de l'économie de marché, les principaux bâtiments dédiés à la vie collective n'avaient plus leur place dans ce nouveau monde. Ils ont donc été laissés à l'abandon ou privatisés. On a différentes situations qui sont inhérentes à l'histoire de la Russie à ce moment-là. En revanche, la vraie rupture que j'identifie, c'est ce que j'appelle le réinvestissement dans le patrimoine soviétique. Et il se joue dans deux directions au tournant des années 2000 : d'une part dans les mouvements citoyens de la société russe et d'autre part des intérêts de l’État. Si l’on ne parle que de la partie architecturale soviétique, on peut distinguer deux grands types de bâtiments : les bâtiments modernes (les bâtiments d’Avant-garde des années 1920-1930 mais aussi les bâtiments construits entre les années 1960 et la chute de l'URSS, deux formes de modernisme architectural), et par ailleurs, au milieu, l'architecture stalinienne (l’architecture qui va de 1932 jusqu'aux années 1955 environ). Dans les années 2000, lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il y avait des idées dominantes : former une Russie unie, le maître-mot de toute la politique russe, promouvoir une histoire linéaire, sans ruptures, articulée autour des idées de puissance, de héros et de grandes victoires du peuple.
LDDP : À écouter les dirigeants russes aujourd’hui, on a l’impression qu'il y a une continuité entre le passé tsariste et le passé communiste. Au moment du centenaire de la révolution de 1917, l'absence de grandes manifestations populaires était frappante. Comme si finalement, le pouvoir russe piochait dans la période tsariste et communiste sans ce soucier de la cohérence et de la rupture effective qui a existé après 1917. Comment pouvez-vous l’expliquer ? Est-ce une façon de réconcilier la population russe avec son passé quitte à être incohérent ? Et est-ce qu’aujourd’hui, ces deux périodes – tsariste et communiste – sont traitées de manière différente par le pouvoir ?
JD : Concrètement, cette idée de construire une nouvelle identité nationale a pris un certain temps. Ce qui est normal pour un pays qui se reconstruit avec des fondements fragiles dans les années 1990. Dans l'idée, cette histoire linéaire permettait d'accentuer la filiation totale entre toutes les périodes historiques connues par la Russie. En faisant certains choix, effectivement, mais la mémoire c'est avant tout une histoire de choix. Il y a trois grands piliers finalement : la grande puissance, les grandes victoires et la religion orthodoxe. Donc en terme de patrimoine cela se traduit par quoi ? Autour de 2005, il y a eu un tournant historique qui a pris la forme d'une revitalisation de la période soviétique, de la Grande Guerre patriotique et donc de la figure de Staline. C'est par là qu'il est véritablement réapparu, il n'est pas sorti de nulle part. En matière d’architecture, cela s'est traduit concrètement. À la station de métro Kourskaïa, à Moscou, par exemple. En effet, en 2009 la municipalité de Moscou a fait inscrire une partie de l'hymne soviétique de 1939 et on y trouve notamment cette phrase : « nous étions élevés par Staline pour servir fidèlement le peuple et il nous a inspiré dans notre travail et dans nos exploits ». Donc ça, c'est une réinscription dans l'espace public d'une remémoration positive de la figure de Staline. Cela s'est traduit également par la restauration de lieux qui rappelaient la grandeur stalinienne. On pense évidemment au parc VDNKh qui a subi plusieurs transformations consécutives. Et enfin cela s'est traduit par la reconstruction de certains bâtiments, notamment le pavillon de l'exposition universelle de 1937 devant le parc VDNKh, bâtiment surmonté d'un symbole fort de l'URSS : l'ouvrier et la kolkhozienne. Cette décision est très forte. C'était le symbole par excellence de la gloire soviétique à l’internationale, via Mosfilm notamment, et en 1937, ce pavillon soviétique faisait face au pavillon nazi. Il y a donc plusieurs couches mémorielles qui se superposent ici. C'est le paroxysme de ce réinvestissement soviétique dans l'espace public. C'est ce que j'appelle le patrimoine de la grandeur qui fait écho à cette histoire linéaire.

Sur Tchéliabinsk, comme sur toutes les villes de Russie, Vladimir Lénine veille (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Est-ce que l’on peut parler de tourisme patriotique lié au patrimoine soviétique en Russie, que ce soit chez les touristes russes ou étrangers ?
JD : En réalité cela dépend de quoi l’on parle. Il y a d'une part ces grands symboles assez grandiloquents qui par leur taille, les messages qu'ils délivrent et les images qu'ils véhiculent (les Sept sœurs de Staline par exemple) sont vraiment mis en valeur. Ils sont inscrits touristiquement dans la skyline de Moscou quand on regarde des vidéos promotionnelles réalisées par et pour la ville. Récemment, une vidéo a été réalisée pour l'anniversaire de Moscou. Quand on regarde les bâtiments promus, on a la place Rouge, quelques églises et l'Ouvrier et la kolkhozienne. Donc voilà, on a cette linéarité qui est mise en valeur. De l'autre coté, on a un abandon, un rejet total des bâtiments plutôt modernes, notamment d’Avant-garde. C'est ceux-là que l'on trouve principalement à l'abandon en Russie aujourd'hui. Parce qu'ils ont subi la fuite du temps un peu plus fortement que d’autres, parce qu'ils étaient construits dans des matériaux plus fragiles. Ils ont subi plus fortement les conséquences économiques de la chute de l'URSS aussi et n'ont pas été repris en main dans les années 2000. Ils ont été soit détruits, pour laisser place à des projets immobiliers plus rentables, soit abandonnés. Leur image est souvent abimée en Russie alors que la communauté internationale a tendance à voir en eux des chef-d’œuvres à protéger de façon urgente, voire à inscrire au Patrimoine mondial de l'Humanité. Quand, en Russie, ils sont considérés comme inutiles, laids, et n'incarnent pas la grandeur ! Ils ont été construits dans une période plutôt rejetée par le gouvernement russe à savoir la période révolutionnaire. Durant cette période, ces bâtiments étaient utilisés dans une logique collectiviste, révolutionnaire, expérimentale. Et, aujourd'hui, le pouvoir russe ne veut bien entendu pas de cela. En outre, il y a également une méconnaissance historique de ces bâtiments-là. Il ne faut jamais négliger l'ignorance.
LDDP : Tout ceci nous amène à une autre question : est-ce qu'il y a des figures de la défense du patrimoine soviétique en Russie ?
JD : Justement, dans ce constat général d'abandon et de rejet du patrimoine des avant-gardes, il y a eu plusieurs étapes dans la constitution d'un mouvement citoyen pour sa préservation. Ce mouvement a été impulsé par des dynamiques internationales, notamment avec des textes importants qui ont été signés. On peut penser à la déclaration de Moscou de 2006, impulsée par Icomos (le conseil international des monuments et des sites). En réalité, 2006 est l'année du changement à ce niveau-là. Il y a un électrochoc. La communauté internationale avec des experts russes et internationaux oblige la Russie qui est membre de l’Unesco depuis 1954 (et qui a 28 sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco d'ailleurs) à protéger certains bâtiments d’Avant-garde. Donc d'un coté on a cette communauté internationale qui commence à se mobiliser. Plus généralement, dès les années 1990 et dans les années 2000, plusieurs bâtiments soviétiques ont été mis dans des listes d'édifices à protéger par des groupes publics et privés internationaux. Il s’agit pour beaucoup de bâtiments d’Avant-garde. La communauté internationale a donc eu peur du devenir néfaste programmé pour ces bâtiments. En réaction à cela, il y a eu plusieurs phénomènes venus de l'étranger. Quelques journalistes étrangers vont lancer une association à Moscou : la Moscow Architecture Preservation Society (MAPS) afin de protéger certains bâtiments soviétiques russes. C'est de là qu'est née la principale association moscovite de protection du patrimoine « Archnadzor ». Et par ailleurs, depuis 1965, il existait déjà une société de préservation des monuments (VOOPIK). Ces sociétés et associations mises à part, il existe également des initiatives locales. Leur but principal est souvent de réagir face à des décisions du gouvernement : mauvaise restauration ou destruction par exemple. Et jamais de façon plus générale. C'est très ponctuel. Différents acteurs ont émergé à ce moment-là : des gens très cultivés, plutôt à haut capital culturel et financier, des gens qui sont eux-mêmes historiens de l'architecture, historiens du patrimoine, architectes, etc. Ce sont également des gens qui ont eu l'occasion de voir de leurs propres yeux un bâtiment être détruit et qui ont été frappés émotionnellement par cela. Et enfin, ce serait plutôt des étrangers.

Julie Deschepper est doctorante et enseignante à l'Inalco à Paris (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Ces gens-là sont donc capables de se mobiliser lors de différents événements ?
JD : Ils se mobilisent oui. Ils ont différentes stratégies. Cela peut être des manifestations avec des panneaux. Ça peut être de faire de la sensibilisation au patrimoine dans la presse par exemple. Il y a donc une véritable partie de la société qui est capable de se mobiliser. Cela est lié notamment au fait que l’Avant-garde et le constructivisme sont devenus un phénomène de mode qui touche les hipsters par exemple, allant même jusqu'au tourisme. Depuis 2014, on observe un phénomène de densification du tourisme autour des bâtiments soviétiques au sein même de la Russie de la part de la population. Jeunes, trentenaires, hipsters, ils sont amateurs de visites de ces monuments. A titre d'exemple, lorsque j'ai commencé ma thèse en 2014, une toute petite association venait de se créer : elle faisait des visites de monuments soviétiques mais aussi tsaristes : Moscou vue par un ingénieur (lire notre article sur le sujet, NDLR). Aujourd'hui c'est devenu une énorme filiale qui connait un nombre de visiteurs Russes ou étrangers tout à fait phénoménal. Ils font des visites tout à fait atypiques. Ils se sont développés, hispterisés. Et ça fonctionne ! Il y a une fascination, un phénomène de mode. En revanche ce phénomène n'est pas le même à Saint-Pétersbourg par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas là-bas alors même que c'est la ville de la révolution, alors que c'est là-bas que sont nés certains mouvements de préservation du patrimoine en Russie. Il y a un hiatus à faire parler ici. A Saint-Pétersbourg, les bâtiments d’Avant-garde tombent en ruines, c'est frappant.
Cela nous permet de revenir à votre précédente question : il n'y a effectivement pas eu de célébrations officielles pour le centenaire de la révolution. Ça nous indique que la révolution a du mal à s'inscrire dans le discours officiel. Alors que la Grande Guerre patriotique est devenue l'élément fondateur de l'identité nationale. Ce qui est célébré en 2017, c'est l'idée d'une période historique qui comprendrait l'année 1917 dans son ensemble et qui s'étendrait peu ou prou jusqu'à la fin de la guerre civile. Cette période-là serait un moment de basculement historique, ni tragique ni absolument phénoménal, mais au contraire qui a conduit à la création de l'URSS et donc à cette grande union. Donc pas de distinctions entre février et octobre 1917 par exemple, pas d'accentuation sur la guerre civile, on glorifie au contraire un grand moment national. Il y a donc une idée de linéarité, les grands moments de rupture sont absents. L'idée est donc de ne garder que les côtés positifs de la création de l'URSS. En terme patrimonial, ce a quoi ça a donné lieu est assez fantastique parce qu’à Moscou, on n'a pas célébré la révolution en grande pompe, en revanche on a célébré le 870ème anniversaire de la Ville de Moscou dans les rues. Et pour célébrer cela, il y avait des reproductions miniatures des bâtiments d’Avant-garde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’aujourd'hui, le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'état de délabrement des monuments, mais surtout, il a compris qu'il fallait agir et d'urgence parce que la population russe est mobilisée tout comme la communauté internationale.
Du coup, il y a tout un programme de patrimonialisation qui a été lancé en Russie pour le meilleur et pour le pire. On l'a vu lors de la Coupe du monde de football 2018 : tout un pan de la communication autour de l'événement était dédié au constructivisme en Russie. Il y avait des affiches dans le métro pour aller visiter les bâtiments d'Avant-garde car les dirigeants russes savent pertinemment que les étrangers s'intéressent à cela.
LDDP : Parlons un peu de l'urbex (ou exploration urbaine), cette discipline qui se développe un peu partout dans le monde et surtout en Russie et qui amène des individus à parcourir la planète à la recherche de ruines abandonnées afin de les prendre en photo de façon plus ou moins artistique, dans un but plus ou moins historique. En regardant un peu sur internet, on se rend compte que cette discipline est presque née en Russie tant il y a de photos, de vidéos, ou encore d'articles traitant de cela dans l'espace post-soviétique. Quel regard portez vous sur ce nouveau phénomène ?
JD : Il y a d’un côté l’urbex comme méthode affirmée de visite des bâtiments, avec tout un réseau qui se développe grâce à des contacts, des informations qui sont gardées secrètes, etc. Et puis il y a l'urbex avec ses touristes, ses visiteurs de passage qui sont attirés par les ruines. Donc il y a deux phénomènes englobés dans un seul terme. Dans les deux cas, c'est une façon de se rapprocher des objets que l'on veut observer, ça permet de prendre d'une certaine façon le pouls de la pierre, de vivre l'histoire qu'elle renferme. Il y a quelque chose de très sensible là-dedans. Ensuite, aujourd'hui il y a un phénomène de mode qui s'est développé et qui est notamment lié à la photographie sur internet et sur les réseaux sociaux. On voit se multiplier des publications avec différentes photographies d'objets abandonnés. Parfois, c'est même un peu gênant. C'est la primauté de l'image sur la réalité historique que renferment ces bâtiments. Parfois, on se fiche de savoir d'où ils viennent, quels étaient leurs buts, pourquoi est-ce qu'ils sont en ruine, qui en est le propriétaire, etc. Je déplore cela. Alors, ensuite on peut également dire que l'on vit dans un monde qui est complètement incertain et cela peut nous permettre de comprendre ce que les gens recherchent en visitant des ruines. L'idée de se rapprocher d'une civilisation close, ça rassure bien entendu. Ça nous rassure dans notre présent qui malgré tout, lui, existe. Contrairement à ce qui est fini. Après, il y a toute cette fascination autour de l'URSS en elle-même. C’est-à-dire que toute la charge idéologique et utopique qu'elle comprend est sujette à fascination. Surtout chez les personnes qui ne l'ont jamais vécue. Ces gens qui ont une connaissance très lointaine voir complètement inexistante de la réalité du terrain. Donc pour moi, voilà un phénomène fascinant.
LDDP : Pour de nombreux touristes étrangers, tout cela est d’ailleurs fascinant, notamment pour ceux qui ont connu le pays fermé, tout comme de nombreuses villes à l'époque soviétique. Peut-on parler d’une recherche du grand frisson dans cette recherche du nouveau ?
JD : Oui, c'est une manière de palper le lointain. C'est le miroir de la destruction de ce mode de vie utopiste, alternatif, complètement différent du monde capitaliste que nous connaissons. Ce sont des ruines qui suscitent une nostalgie imaginaire ou imaginée car elle n'a pas de prise avec la réalité. Alors que la nostalgie dans les faits fait référence à quelque chose que l'on a vécu. Alors que là, ce sont des projections sur des bâtiments que l'on connait peu.

Le soleil se lève sur la skyline moscovite (Photo Lukas Aubin)
LDDP : Oui et cela revient d’ailleurs souvent dans la bouche des Russes : « à l'époque on n’avait rien ou pas grand-chose mais au moins on avait de l'espoir, une idéologie, quelque chose, un but, un rêve ». Même les jeunes Russes qui n'ont connu que Poutine parlent parfois de l'Union Soviétique avec passion…
JD : La projection d'un avenir utopiste ou imaginaire a fait parti du quotidien. Et cette expérience du futur annoncé faisait partie de l'expérience soviétique et ce qui me fascine encore aujourd'hui c'est l'espoir, les croyances qui étaient chargés dans les bâtiments. On sentait qu'ils y croyaient ! Vraiment ! Ils voulaient construire quelque chose de radicalement nouveau qui empruntait aux autres civilisations ! Mais la civilisation que ces bâtiments incarnent, c'est une civilisation qui se voulait universelle, voir universaliste. C'était la fin du monde. C'était l'objectif final. Un monde qui ressemblerait à ça. Ce délabrement, c'est donc l'échec d'un projet alors que nous, il me semble que nous sommes également dans une critique du capitalisme aujourd'hui. Tandis que nous recherchons des modes de vie alternatifs, nous nous retournons forcément vers le passé et observons les échecs.
LDDP : Quand vous dites « universaliste », c'est intéressant car quand on regarde la Russie, on voit bien qu'elle est gigantesque. C'est pratiquement un pays-continent. C’est le plus grand pays du monde. Beaucoup de climats différents, de paysages différents, de cultures différentes... Et pourtant dans cette diversité, il y a une forme de monotonie architecturale. On arrive à Irkoutsk (Sibérie orientale), on a les mêmes bâtiments administratifs qu'à Moscou ou à Ekaterinbourg.
JD : La construction et l'architecture faisaient partie du projet socialiste, c'est un fait. Leur patrimonialisation faisait partie de ce projet-là. En créant du patrimoine, on se crée un passé. En se créant ce passé, on se construit son histoire, sa mémoire historique, et donc on existe. On existe aussi au passé. C'est ça qui est très intéressant. Vous parlez de monotonie, on peut également parler d'uniformité. Visuellement, on reconnaît le soviétique. Quoi qu'il arrive. C'est identifiable par tout le monde, initié ou non. Le gigantisme, la faucille et le marteau, etc. Aujourd'hui les traces de l'URSS sont omniprésentes dans l'espace public. La gestion de ces traces, on comprend bien que ça ne peut pas être quelque chose de réglé du jour au lendemain. Une réelle politique patrimoniale doit être mise en œuvre. Ça n'a jamais été le cas en Russie. Il n’y a même pas eu de politique mémorielle. C'est pour cela que l’on a de mauvaises interprétations. Une telle politique éviterait peut-être que des statues de Staline réapparaissent çà et là dans des petits villages situés au fin fond du pays. Et ça, c'est à l'initiative des partis communistes locaux. Le patrimoine en Russie est surtout géré à l'échelle locale en réalité. C'est pour cela qu'il y a une énorme différence entre ce qui se passe à Moscou par exemple, à Saint-Pétersbourg et à Ekaterinbourg. Ekaterinbourg est intéressante à ce propos car là-bas, il existe une politique de préservation du patrimoine d'Avant-garde, mais surtout de sa valorisation et du développement touristique destiné aux Russes et aux étrangers. Ekaterinbourg se veut aujourd'hui la capitale de l'Avant-garde depuis la période 2010-2015. Que s’est-il passé ? Les citoyens eux-mêmes ont racheté des monuments, ils les ont eux-mêmes restaurés à la force de leurs pinceaux et avec leurs propres moyens. Ensuite, ils ont développé dans la ville un trajet touristique qui s'appelle le fil rouge pour visiter la plupart des monuments historiques constructivistes. Aujourd’hui, il y a une biennale d'architecture qui a lieu à Ekaterinbourg. Et surtout, le gouvernement local propose d'inscrire ces bâtiments au patrimoine mondial de l'Unesco. Donc on voit des choses totalement différentes. Il faut savoir que la Ville d’Ekaterinbourg est la seule ville qui a eu un maire d'opposition au cours de ces dernières années, Evgueni Roïzman (lire notre portrait d'Evgueni Roïzman réalisé en 2014, NDLR). C'est une ville qui cherche à développer son identité locale et régionale en opposition à Moscou et qui veut valoriser son patrimoine. On voit bien qu'on a des stratégies différentes en fonction des régions et des villes de Russie. Les choses sont cependant en train de bouger depuis le tournant des années 2000-2005. Les mouvements de citoyens dans les années 2010 ont pris une ampleur phénoménale, et il y a aujourd’hui un nouveau mouvement qui est en train de se lancer, un mouvement de valorisation du patrimoine de la part des autorités.