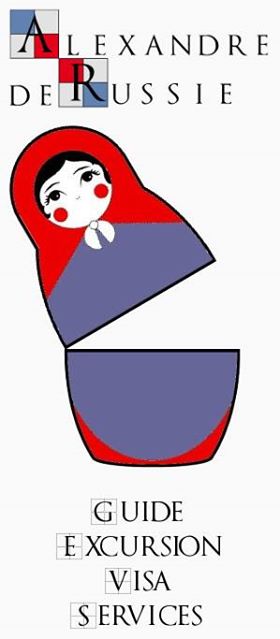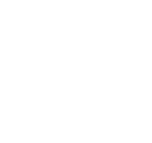Corbillard, vodka et aspirine : l’Oural hallucinatoire des Petrov
« Il suffisait à Petrov de prendre le trolleybus pour se faire aussitôt assaillir et importuner par des fous ». L’incipit du roman d’Alexeï Salnikov présage un récit échevelé, jalonné de rencontres impromptues. Bien que né à Tartu, en Estonie, en 1978, Alexeï Salnikov est un écrivain enraciné dans l’Oural où il a d’abord exercé différents métiers techniques. Entretien.
Paru en 2017, le roman Les Petrov, la grippe etc., raconte quelques jours du mécanicien Petrov embrumés par l’alcool, la fièvre et les souvenirs d’enfance. Récompensé par deux grands prix littéraires en Russie, ce livre d'Alexeï Salnikov a été porté sur scène et son adaptation cinématographique par Kirill Serebrennikov doit sortir en salles en 2021. La traduction française de Les Petrov, la grippe etc. a été publiée cet été aux éditions des Syrtes.
La Dame de Pique Média : Avant d’acquérir la notoriété avec Les Petrov, vous avez travaillé comme opérateur de chaufferie, mécanicien de garage ou encore plombier. Que vous ont apporté ces expériences sur le plan littéraire ?
Alexeï Salnikov : A cette époque, j’écrivais essentiellement de la poésie car c’était la forme qui se prêtait le plus à mon quotidien. Il faut s’imaginer à quoi ressemblait une chaufferie près de Nijni-Taguil, dans l’Oural, à la fin des années 1990 : dans un état de déliquescence qui nous contraignait régulièrement à l’évacuer. Nous avions des problèmes avec les appareils et devions constamment surveiller le niveau d’eau, ce que nous n’étions théoriquement pas censés faire. C’était plus calme l’été et nous avions, de fait, plus de temps. J’écrivais, sans arrière-pensées. Puis j’ai rencontré Vladimir Tourenko, un poète admirable d’Ekaterinbourg, et c’est grâce à lui que tout a commencé. Mes premiers écrits ont été publiés directement dans une revue.

L'auteur Alexeï Salnikov © Editions des Syrtes
LDDP : Les membres de la famille Petrov sont réduits à ce nom de famille générique en Russie. Pourtant, l’histoire est ancrée dans un lieu précis, la ville d’Ekaterinbourg. Pourquoi ?
AS : Au tout début du printemps, quand la neige commence à fondre et que la végétation n’a pas encore repoussée, la ville est une authentique représentation de l’Enfer. Où pourrait-on s’imaginer Hadès si ce n’est à Ekaterinbourg, dans les entrailles d’une région où l’on fore le sous-sol pour ses ressources ? Mais c’est aussi une ville que je connais bien. Son centre est intéressant mais sa périphérie l’est plus encore, particulièrement la nuit. A n’importe quelle heure, quand la majorité dort depuis longtemps, on y croise des types qui traînent, sans raison apparente. Et contrairement à ce qu’on pourrait supposer, ils ne sont pas agressifs. Ce tableau peut apparaître sinistre mais je l’observe avec intérêt.
LDDP : Pourtant, l’univers décrit dans le roman apparaît assez hostile. Les personnes sont constamment victimes de facteurs extérieurs : du froid, de la grippe mais aussi de contacts humains indésirables…
AS : C’est mon caractère introverti qui ressort ! Dans ce livre, j’ai d’abord voulu parler des connexions entre les êtres humains au-delà de la famille et des proches. Les gens se croisent dans la rue, certains se sont probablement déjà rencontrés il y a une dizaine d’années, ont même pu se rendre service, mais ces visages ont été effacés de leur mémoire. Les rencontres relèvent bien souvent d’un hasard qui, ensuite, oriente notre existence, dans la bonne ou la mauvaise direction. Je me souviens, par exemple, avoir avancé de l’argent à un voisin afin qu’il puisse s’acheter de l’alcool. Un peu plus tard, j’ai appris qu’il était mort. Ce même scénario s’est répété avec deux autres personnes ! Il m’a inspiré une nouvelle.
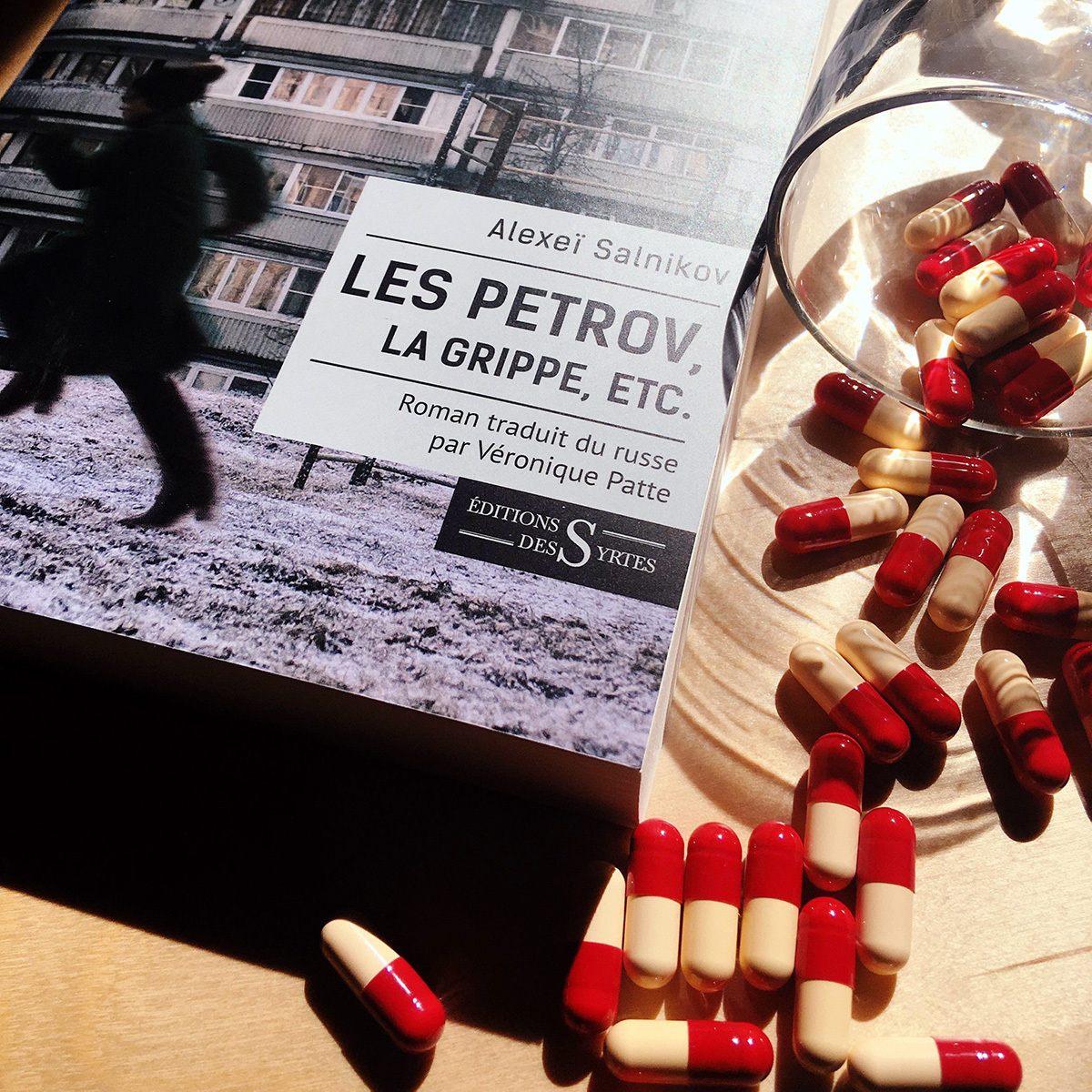
© Editions des Syrtes
LDDP : De la contrôleuse de trolley « en voie de disparition » à l’atmosphère des cages d’escalier, le livre fourmille de détails inhérents au quotidien russe. Y avait-il une démarche consciente de saisir la Russie contemporaine ?
AS : Plus précisément, j’ai situé cette histoire au milieu des années 2000. J’ai voulu fixer, avec une certaine nostalgie, cette période qui a vu apparaître les communications modernes en Russie, quand les téléphones avec messagerie vocale disparaissaient progressivement. Les gens venaient tout juste de s’extraire de la crise financière et de sortir la tête de l’eau. On ne laissait pas encore les enfants sortir sans surveillance. Cette période s’est refermée rapidement : le contexte a changé, la situation des Russes s’est améliorée d’un point de vue matériel. Pas sur le plan politique !
LDDP : Qu’il s’agisse de la place centrale de la femme, de la passivité masculine ou de l’éducation des enfants, la cellule familiale semble par contre avoir peu changé d’une génération à l’autre…
AS : Je crois que les familles se sont apaisées. Il y a moins de violence, notamment envers les enfants. Désormais, les gens préfèrent jurer plutôt que de se battre. La société s’est calmée car sa lutte pour la survie a été dépassée : les gens ont de quoi manger et jouissent d’un certain confort matériel. Les femmes conservent un rôle structurant. C’est une tradition russe : les hommes devaient être mobilisables à tout moment, on pouvait les envoyer à la guerre, sur un chantier ou en prison. Ils ont tendance à oublier les problèmes dans l’alcool alors que les femmes, elles, les affrontent. Mais cela change : aujourd’hui, on les voit faire du vélo ou de l’escalade.
Et l’éducation ?
Les années 1990 ont brisé les certitudes façonnées durant sept décennies de communisme. La vie en Union soviétique était prévisible et l’on savait qu’aller à l’université permettait de réussir. La génération de parents à laquelle j’appartiens est elle aussi un peu déboussolée : à 16 ans aujourd’hui, on peut perdre son temps bêtement devant Tik-Tok et gagner davantage que toute la famille réunie !

L'auteur Alexeï Salnikov © Editions des Syrtes
LDDP : Dans Les Petrov, une forme de folie surgit d’un quotidien banal de la vie provinciale russe. On retrouve ce même contraste dans le film Strana Oz (Vassili Sigarev, 2015) dont l’histoire se déroule également à Ekaterinbourg…
AS : Quand je croise à l’épicerie du coin, par trente degrés, des femmes en robe de chambre et pantoufles, j’ai tendance à penser que cela ne peut se produire qu’à Ekaterinbourg. Mais il s’agit plus globalement d’un trait russe que l’on relève déjà chez Gogol. Avec ce livre, j’ai voulu raconter cette folie de nos jours. Je crois que les Russes se laissent volontiers happer par la folie. Ils sont plutôt enclins à sortir du cadre de la normalité et à s’engager dans cette petite aventure, sans pour autant tomber dans la pure démence. Et je crois que la famille, malgré les tensions et les crises, préserve de cette folie. Ensemble, les Petrov parviennent à rester normaux.
LDDP : Le livre a été beaucoup commenté en Russie. Vous est-il arrivé de lire des extrapolations critiques à son sujet ?
AS : Selon moi, il n’y a pas de mauvaises interprétations. Je restitue des scènes que je vois et un certain état d’esprit. La réception dépend de chacun. Mais c’est vrai qu’il existe cette tendance dans la littérature russe à chercher un sens profond à une œuvre. Derrière chaque écrivain demeure le spectre de Tolstoï et de Dostoïevski. Mais quel est le sens véritable de Guerre et paix, de Crime et châtiment ? Nous imaginons que ces livres recèlent forcément une part d’inaccessible alors qu’il suffirait simplement de les lire.

Alexeï Salnikov, Les Petrov, la grippe, etc., éditions des Syrtes, 2020. Traduit du russe par Véronique Patte.
Découvrez la bande-annonce du film de Serebrennikov :